Ce syndrome fait référence à l’expérience vécue en 1817 par l’écrivain français Stendhal lors de son voyage en Italie. À la vue des beautés de la ville de Florence, il se sentit faiblir, pensant même perdre connaissance.
Ce syndrome se manifeste par des palpitations cardiaques, des vertiges et même des hallucinations. Moi aussi, comme Stendhal, ce truc m’est arrivé, non à Florence, mais au musée du Moma, à New York.
D’abord, sachez que je me décris —le plus souvent — comme un artiste de pixel, mais je dois vous avouer que la peinture est le médium qui me fait le plus d’effet. Peut-être parce que j’ai longuement étudié ce médium à travers l’histoire de l’art du 19e et du 20e siècle.
En fait, j’admire les artistes qui poussèrent toujours plus loin les limites de ce médium : le figuratif vs l’abstrait, l’hyper minutie vs le geste spontané, la forme vs la ligne, les couleurs vibrantes vs les tons sombres.
J’arrive donc au Moma dans la salle où l’on vend des représentations des tableaux des grands Maîtres. J’aperçois entre autres «La Danse» de mon peintre préféré Henri Matisse et je poursuis ma marche.
Jusqu’ici rien d’anormal, du moins dans ma tête.
Les escaliers roulants m’emmènent ensuite au 5e étage. Le musée ferme à 20h. Il est 18h45. Je le mentionne, car je crois que ce manque de temps a joué sur mes sens.
Cézanne, Matisse, Van Gogh, Derain, Picasso…
Au début, je vais d’une toile à l’autre. Toujours avec un peu plus d’intérêt et de satisfaction, comme un enfant émerveillé. Je regarde ces toiles de Paul Cézanne en particulier. C’est très beau! Très touchant!

Selon plusieurs, la peinture moderne commence avec ce peintre qui peignait ses paysages et ses natures mortes, non pas conformément au réel, mais avec de grosses touches de couleur, selon une géométrisation de l’espace. Comme si sa toile était une sculpture.
Puis, cette œuvre de Van Gogh arriva à moi (ou moi à elle, je ne sais pas). Je ressens dans ma chair l’ardeur de ses coups de pinceau. L’anxiété qui déforme l’espace. Mon cœur commence à battre un peu plus vite. J’ai toujours aimé Vincent et son oreille.

C’est au tour de Gauguin avec ses aplats qui annulent la perspective. Il est 19h10. Le temps passe quand même vite. Un gardien du musée me salue de la tête.
Ensuite, ce sont les fauvistes, comme André Derain, qui peignaient avec des couleurs vives et souvent improbables dans le réel. Moi, je continue de prendre des photos, un peu comme si je photographiais mes propres pensées. 19h20.

Picasso se pointe alors et remet tout en question, poursuivant la géométrisation de Cézanne. Braque fait aussi partie des expérimentations. Les formes, les corps, les paysages deviennent plus anguleux, presque «cubiques», mais gardent toujours un lien avec le réel. Il est 19h30.
Ayayaille!

Puis, cette toile de Mondrian et une autre de celui qui, à la fin de sa vie, n’allait peindre que des lignes et des rectangles de couleur, selon le commun des mortels. Mais moi, dans mon cerveau, l’espace du tableau devient soudainement infini. Par en avant comme par en arrière. Les rectangles essaient s’équilibrer les uns par rapport aux autres. Là, le peintre ne représente plus une copie du réel, mais sa toile devient le réel.

Dans une autre salle, je tombe sur un ready-made de Marcel Duchamp. Une roue de bicyclette vissée sur un tabouret. Duchamp nous dit :
«Ça, c’est de l’art!»
Et moi, face à cette œuvre, je reste pantois, tout comme le 20e siècle qui ne s’en est jamais vraiment remis.
Puis, vint cette salle, celle où mon cerveau se mit littéralement à genou. Des Matisse sur tous les murs, tout autour de moi. Des tableaux dont les couleurs se mêlent à la perspective, celle qu’on finit par deviner. Je reste là pendant que mes yeux se gavent d’un festin de couleurs, je fais 3 X 360 degrés sur moi-même, je multiplie les photographies.
J’ai chaud.

Je me retourne devant le grand tableau de Matisse qui s’intitule : La danse. Je ne peux m’arrêter de photographier. J’avais toujours cru que tableau fut peint avec la plus grande précision, le contraire d’un Jackson Pollock. Mais, en m’approchant, je me rends compte des dégoulinures autour des formes souvent floues, comme si Matisse ne s’en faisait plus et dansait avec sa peinture, enfin libérée de toute contrainte.

Et voilà que ma tête se met à tourner. Je n’ai plus de temps, je vais tomber. Un gardien de sécurité me crie d’arrêter, de m’éloigner de la toile. Je pèse une dernière fois sur le déclencheur.

Plus tard, à l’entrée du musée, un gardien vient me donner un verre d’eau. Moi je suis assis sur le plancher froid. Je ressens encore des palpitations. Puis, je pense à Stendhal. 20h20. C’est la fin, je crois.
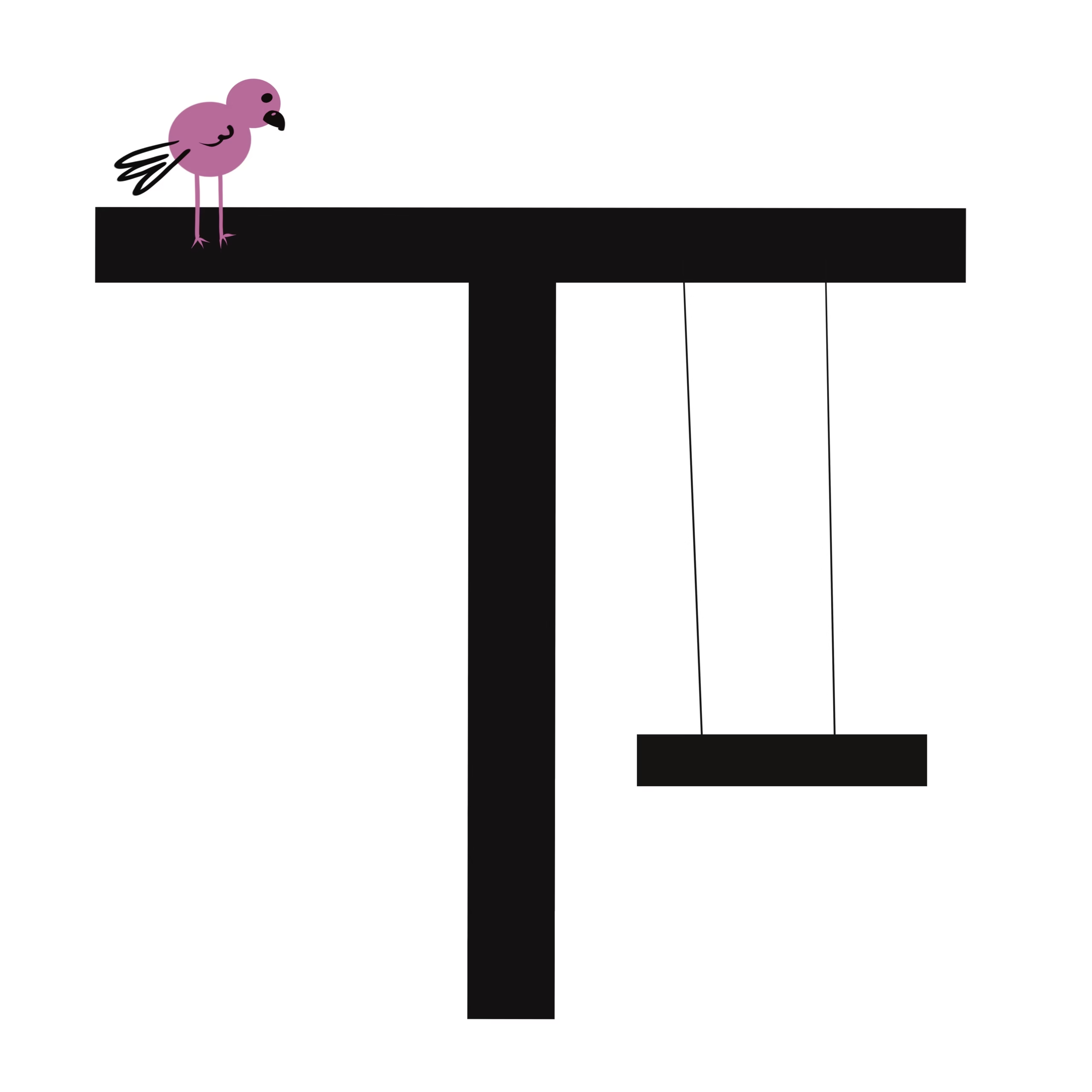

Laisser un commentaire