Parlons un peu de Georges Brassens, ce grand auteur-compositeur-interprète trop modeste pour se considérer comme un poète.
Il se considérait volontiers anarchiste.
Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, Brassens offre ses services pour travailler au journal Le Libertaire. Il y signe des textes virulents contre la police, l’armée et l’Église. Bref, il dénonce tout ce qui s’apparente à des tentatives d’embrigadement par la manipulation ou l’oppression. Et le tout sous des pseudonymes aussi éloquents que Gilles Corbeau, Géo Cédille, Charles Malpayé ou Pépin Cadavre.
Il est membre de la Fédération anarchiste. Il l’a quitte toutefois en 1948, parce que trop individualiste et indépendant d’esprit pour suivre un mouvement politique quelconque. Ce qui est bien là la marque d’un esprit libre. Ainsi, il se fait la voix des idées libertaires mises de l’avant par le mouvement. C’est pourquoi anticléricalisme, amour libre et antimatérialisme sont des éléments toujours présents, ne serait-ce qu’en filigrane, dans ses chansons.
J’ai décidé de m’attarder à l’antimilitarisme de Brassens. Non seulement il a connu l’Occupation lorsqu’il était à Paris dans les années 40, mais il a dû contribuer à l’effort de guerre nazi, enrôlé de force par le Service de travail obligatoire. Il en a retiré un dégoût des conflits armés et du militarisme en général.
On en retrouve l’écho dans cinq de ses chansons, la première étant:
La mauvaise réputation
« Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. »
Voilà une des formules les plus marquantes de cette chanson. En plus de célébrer le libre arbitre et l’individualisme, elle s’en prend au conformisme. Ainsi les « braves gens » ne tolèrent pour ainsi dire jamais qu’on puisse dévier d’une morale tacitement admise. Ils ne tolèrent jamais non plus qu’elle soit remise en question sous peine de se voir ramener à l’ordre assez brutalement. Dans cette chanson, le narrateur finit au bout d’une corde. Il ne demandait pourtant rien à personne et vivait selon ses principes, tout bonnement.
Bien sûr, ce n’est qu’une amorce. Et même si l’armée et le militarisme ne sont pas les thèmes les plus récurrents de son répertoire, toutes les fois où il s’y est attaqués cela a soulevé un tollé chez les bien-pensants. N’ayant jamais eu la fibre militante, il utilise à profusion le second degré, voire l’ironie, pour exprimer son peu d’estime vis-à-vis cette institution. Bref, il pique au vif, comme on dit. Et quand on sait que les bourgeois ont la peau sensible, ils réagissent d’autant plus fort.
Comme dans le cas de la chanson suivante.
La guerre de 14-18
Brassens fait ici flèche de tout bois. Du bourrage de crâne par le biais des manuels d’histoire de la petite école relatant actes de sauvagerie tous plus « édifiants » les uns que les autres, jusqu’au constat que la même histoire n’en finira sans doute pas de se répéter.
Entre les deux, il énumère, tel un enfant malicieux, des conflits armés ayant laissé leur trace (Sparte, les campagnes de Napoléon, le conflit franco-allemand de 1870, la Seconde Guerre mondiale) pour ne retenir que sa « favorite », soit la guerre de 14-18. Le tout sur un rythme évoquant quelque peu une marche militaire.
Publiée en 1962, cette chanson a suscité des réactions d’autant plus vives que la France sortait tout juste de la guerre d’Algérie. Elle y laissait les dernières plumes de son empire colonial. Il s’explique sur cette chanson quelques années plus tard, soutenant qu’il n’a jamais voulu attaquer les combattants morts ou diminués physiquement au cours de ces guerres, les considérant comme des victimes du jeu des grandes puissances et de leur bellicisme.
Et c’est dans cet esprit qu’il récidivera deux ans plus tard avec cette autre chanson.
Les deux oncles
Ici, il semble s’en tenir spécifiquement à la Seconde Guerre mondiale. Il attaque surtout une conséquence non négligeable de toute guerre: un effet polarisant à l’intérieur des pays concernés, où s’opposent pacifistes et guerriers, collaborateurs et patriotes, bref traîtres et loyaux sujets. Et là il renvoie simplement dos à dos l’Oncle Martin (qui aimait les Tommies) et l’Oncle Gaston (qui aimait les Teutons) en affirmant « qu’il est fou de perdre la vie pour des idées. »
Non seulement il annonce Mourir pour des idées, qu’il sort 8 ans plus tard, mais il lance un gros pavé dans la mare gaulliste avec cet appel à la réconciliation, dans une France encore mal remise de ses déchirements internes 20 ans après la fin des dernières hostilités – qu’on pense aussi à La tondue qui était d’ailleurs parue sur le même album. Le fait qu’il ridiculise aussi au passage les salamalecs militaristes de toute nature n’a pas dû aider non plus à sa réception.
Il adoucit quelque peu le ton à la fin en en évoquant:
« Malbrough qui va t-en guerre au pays des enfants »
et en implorant
« les heureux coquins qui ce soir [verront] Dieu »
d’offrir des myosotis à ses oncles. En y pensant bien, Brassens était peut-être plus pacifiste qu’antimilitariste, même s’il affirmait:
« Je déteste les uniformes, sauf celui du facteur ! »
Les patriotes
Là, pas de mystère: il oppose carrément « faire la guerre » à « faire l’amour ». Le tout en égratignant le drapeau tricolore et la Marseillaise et en évoquant le sort que feraient subir les militaristes les plus enragés à quelques symboles de paix.« La colombe de la paix, on l’apprête aux petits oignons ! »
En effet, l’auteur n’hésite pas à employer les images les plus paillardes. Aussi, avec la violence de certaines des autres images qu’il emploie, il suggère que l’esprit militaire s’avère particulièrement buté et étroit d’esprit dans son désir de violence.
À ce propos, il règle le cas de ceux-là dans une autre chanson qu’il n’aura pas le temps de sortir de son vivant et simplement appelée…
La guerre
En plus de s’en prendre au militarisme, il se livre dès le premier couplet à une réflexion sur la nature humaine qui peut sembler assez déprimante.
« À voir le succès que se taille / Le moindre récit de bataille / On pourrait en déduire que / Les braves gens sont belliqueux. »
Puis il laisse entendre que le prétendu courage de ces gens disparaîtrait bien vite si on les mettait devant le fait accompli.
« C’est beau les marches militaires / Ça nous fait battre les artères / On semble un peu moins fanfaron / Dès qu’on approche du front. »
Tant il est vrai que le véritable courage est de savoir dominer ses peurs, on ne peut que s’interroger sur les véritables motivations de ceux qui poussent les autres au combat.
Mmm… Est-ce que j’ai dit qu’il y avait cinq chansons ?
Honte à qui peut chanter
J’ai failli oublier celle-là !
Dans celle-ci, Georges vient nous rappeler que, guerre ou pas, la vie continue et il y aura toujours des chansons. Il évoque successivement la guerre civile espagnole, l’exode qui a suivi la « drôle de guerre » de 1940, le régime pétainiste, l’Indochine et l’Algérie. Il égrene de même les succès de la chanson de ces périodes sombres.
Brassens nous rappelle que les chansons servent autant à nous amuser qu’à nous donner du courage. N’en déplaise aux esprits chagrins et guerriers (ce sont souvent les mêmes) qui considèrent que ceux qui les chantent ne sont pas de « vrais patriotes ».
Il est à noter qu’il reprend la même formule-rengaine que ces gens-là leur servent: « où étiez-vous en 1940 ? » en la déclinant tout le long de la pièce. Sans compter qu’il rend hommage à quelques-uns de ses pairs de belle façon: Charles Trenet, Maurice Chevalier, Jean Sablon, Boris Vian, Gilbert Bécaud, Francis Lemarque et Jacques Brel.
« Le feu de la ville éternelle est éternel. Si Dieu veut l’incendie, il veut les ritournelles. À qui fera t-on croire que le bon populo. Quand il chante quand même est un parfait salaud ? »
Ami(e)s de la chanson, de l’amour et de la paix, à une prochaine fois.
Journaliste et mélomane, Gilles Tremblay s’intéresse aux humains d’exception et à leurs travers. Il en parle sur Temps Libre avec beaucoup d’enthousiasme et de passion.
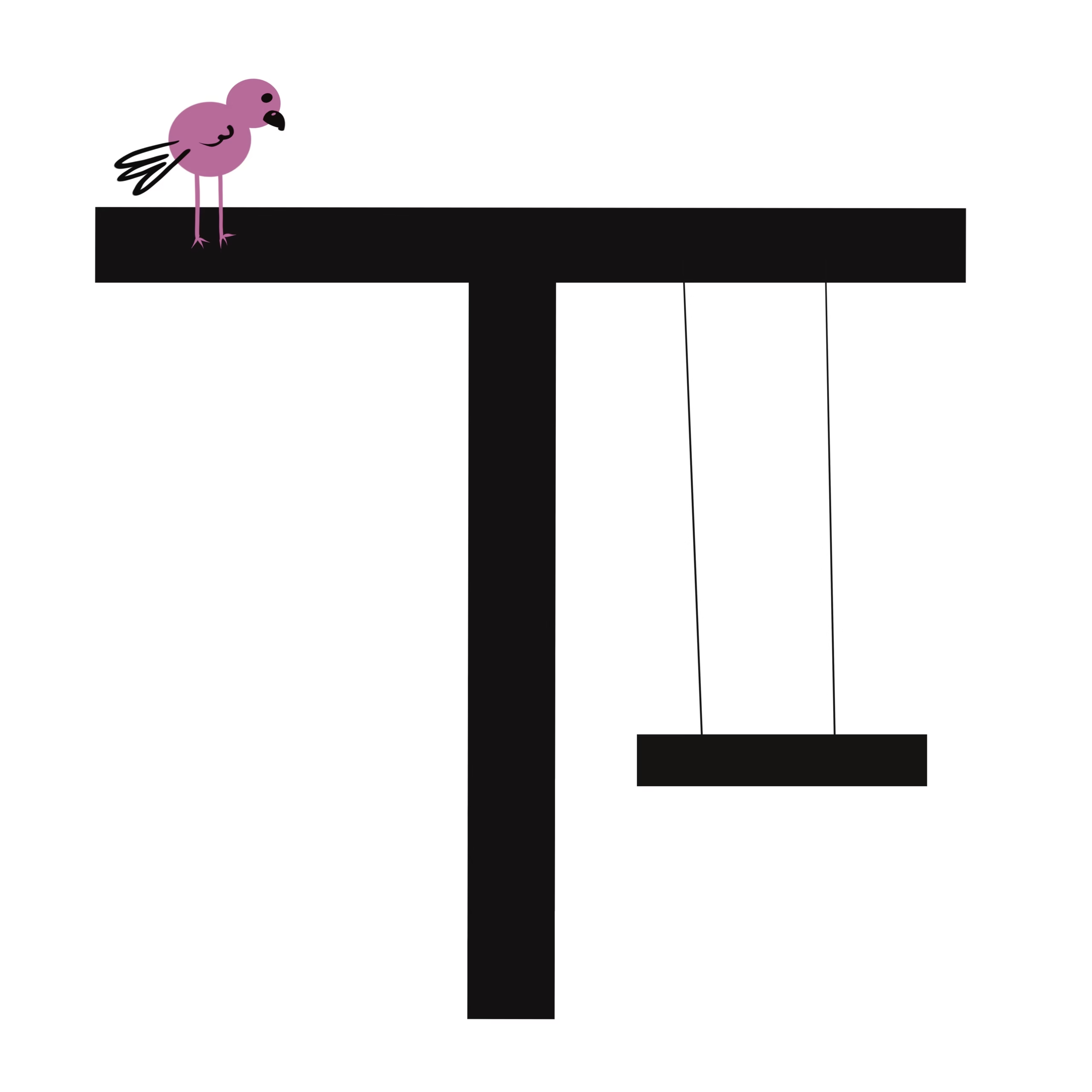

Laisser un commentaire